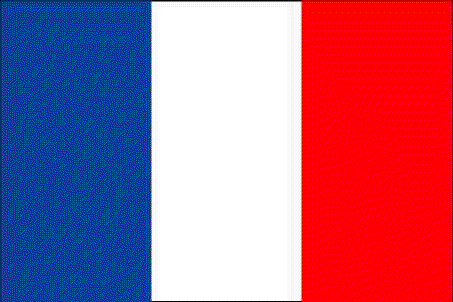Introduction
Sur la demande persistante des populations et en rapport avec la politique de l’Etat de rapprocher les élèves de l’école, le CEM de Bayakh, crée en 1999 est érigé en lycée, en octobre 2008.

Cet établissement périphérique situé à 30 Km de Thiès, capitale de la Région, regroupe un premier et un second cycle de l’enseignement général. Il est confronté à de nombreux dysfonctionnement au niveau de ses effectifs et une insuffisance ou une inadaptation de ses infrastructures et équipements que les nouvelles autorités du lycée (proviseur et censeur) essayent de cerner et de corriger.
L’objectif est d’assurer une meilleure gestion de l’établissement et de solutionner ces manquements par la mise en place de projets d’établissement banquables et l’instauration d’un partenariat Sud /Nord fructueux et réciproque.
C’est dans cet optique que s’explique ce travail d’investigation et de recherche sur l’environnement socio – économique des éléves, afin d’améliorer sensiblement les conditions d’étude et les résultats scolaires au lycée.
Ainsi 638 élèves ont répondu correctement à notre enquête soit un taux de 80% des effectifs.
Ce travail s’articule autour de trois parties :

L’objectif est d’assurer une meilleure gestion de l’établissement et de solutionner ces manquements par la mise en place de projets d’établissement banquables et l’instauration d’un partenariat Sud /Nord fructueux et réciproque.
C’est dans cet optique que s’explique ce travail d’investigation et de recherche sur l’environnement socio – économique des éléves, afin d’améliorer sensiblement les conditions d’étude et les résultats scolaires au lycée.
Ainsi 638 élèves ont répondu correctement à notre enquête soit un taux de 80% des effectifs.
Ce travail s’articule autour de trois parties :
- La présentation de Bayakh et de son lycée
- L’étude de l’environnement socio économique des élèves
- L’analyse des conditions d’étude et des perspectives

Sigles
APE : Association des parents d’élèves
DAGE : Direction Administration Générale et de l’Equipement
IA : Inspection Académique
CEM : Collège d’Enseignement Moyen.
FSE. : Foyer Socio-éducatif
ICS : Industrie Chimique du Sénégal.
Keur : mot wolof qui signifie maison
DAGE : Direction Administration Générale et de l’Equipement
IA : Inspection Académique
CEM : Collège d’Enseignement Moyen.
FSE. : Foyer Socio-éducatif
ICS : Industrie Chimique du Sénégal.
Keur : mot wolof qui signifie maison

Remerciements
Ce travail a bénéficié de la collaboration de deux professeurs d’histoire géographie, Messieurs
AW et Badji. Ce dernier s’est occupé du secrétariat, de la conception des graphiques et des photos.
Je voudrais témoigner ma gratitude et mes remerciements à tous, notamment à Mme le censeur et à tout le personnel de surveillance.
Je voudrais témoigner ma gratitude et mes remerciements à tous, notamment à Mme le censeur et à tout le personnel de surveillance.

Les Sources
Ce travail de recherche a été élaboré essentiellement à partir des fiches d’enquête sociale sur les élèves et sur leurs parents (père, mère, tantes, frères et sœurs…).
D’autres sources écrites comme orales furent utilisées comme :
a) les sources écrites
- Cheikh Tidiane AW : « monographie de bayakh, cité carrefour sur la route des Niayes », U.C.A.D, F.A.S.T.E.F, département d’histoire et de géographie, 2004-2005.
- Diène Dione : l’approvisionnement de Dakar en légumes à partir des Niayes du Cap Vert, mémoire de maîtrise de géographie, U.C.A.D, 1982- 1983.
- Conseil rural de Djender : Plan d’orientation pour le développement économique et social du conseil rural, 2003.
- Gana FALL ; « l’environnement socio _économique des élèves du lycée de Pout, les conséquences sur leurs études et les perspectives », dans bulletin de l’association de l’école, instrument de paix (E.I.P. Sénégal) no 7.
b) les sources orales
Nous avons recueilli les témoignages du chef de village Mandoye Ndiaye, descendant direct du fondateur du village de Bayakh, entretien réalisé en présence de Mor Mbengue, conseiller rural du village et portant surtout sur l’histoire de la localité.
Une enquête a été également menée auprès des directeurs d’écoles arabes de Kayar et de Bayakh, de même que du président de l’association des rapatriés d’Espagne Modou Ndiaye Thioune en compagnie son adjoint Moussa Binta Diop.
D’autres sources écrites comme orales furent utilisées comme :
a) les sources écrites
- Cheikh Tidiane AW : « monographie de bayakh, cité carrefour sur la route des Niayes », U.C.A.D, F.A.S.T.E.F, département d’histoire et de géographie, 2004-2005.
- Diène Dione : l’approvisionnement de Dakar en légumes à partir des Niayes du Cap Vert, mémoire de maîtrise de géographie, U.C.A.D, 1982- 1983.
- Conseil rural de Djender : Plan d’orientation pour le développement économique et social du conseil rural, 2003.
- Gana FALL ; « l’environnement socio _économique des élèves du lycée de Pout, les conséquences sur leurs études et les perspectives », dans bulletin de l’association de l’école, instrument de paix (E.I.P. Sénégal) no 7.
b) les sources orales
Nous avons recueilli les témoignages du chef de village Mandoye Ndiaye, descendant direct du fondateur du village de Bayakh, entretien réalisé en présence de Mor Mbengue, conseiller rural du village et portant surtout sur l’histoire de la localité.
Une enquête a été également menée auprès des directeurs d’écoles arabes de Kayar et de Bayakh, de même que du président de l’association des rapatriés d’Espagne Modou Ndiaye Thioune en compagnie son adjoint Moussa Binta Diop.

Présentation de Bayakh
Le Cadre historique
Bayakh est un terme du parlé Wolof- lébou qui signifie espace, une immensité, une ouverture. Le fondateur du village serait Médoune Ndoye Séye, originaire du Djolof. Ce dernier s’était installé à Bayakh à la recherche des meilleures conditions écobiologiques après avoir séjourné un moment à Ndiaye Diama Niane, un village situé aux environs de Taïba dans la zone actuelle de Mboro. Son neveu, Yaham Ndiaye suivant les traces de son oncle arriva également à Bayakh(1). C’est après lui que commença la succession patrilinéaire avec respectivement Sanou Ndiaye, Modou Ndiaye décédé en 2005 et Mandoye Ndiaye, chef de village actuel de Bayakh.
De la demeure principale de Yaham Ndiaye, l’héritier du fondateur, s’ajoutèrent deux autres « keur » occupés par la famille Mame Mor Mbengue qui succéda à son oncle Mame Mor Diop Adji et la lignée de Abdou Khadr Diaw(2).
La tradition d’accueil prévaudra, épousant le nom du village. Ainsi à la suite des Wolof Lébou, affluèrent les Peuls originaires du Sénégal et de la Guinée Conakry, des maures ou « Naaru kajor », des Diolas de religion chrétienne etc., d’où le caractère cosmopolite de Bayakh(3). Ainsi les habitants vivent en parfaite harmonie sans aucune discrimination. Les mariages inter–groupes très courants en sont une parfaite illustration. Bayakh, par sa diversité ethnique et religieuse, apparaît comme un îlot dans le Diender, fief traditionnel lébou et de confrérie tidiane(4).
De la demeure principale de Yaham Ndiaye, l’héritier du fondateur, s’ajoutèrent deux autres « keur » occupés par la famille Mame Mor Mbengue qui succéda à son oncle Mame Mor Diop Adji et la lignée de Abdou Khadr Diaw(2).
La tradition d’accueil prévaudra, épousant le nom du village. Ainsi à la suite des Wolof Lébou, affluèrent les Peuls originaires du Sénégal et de la Guinée Conakry, des maures ou « Naaru kajor », des Diolas de religion chrétienne etc., d’où le caractère cosmopolite de Bayakh(3). Ainsi les habitants vivent en parfaite harmonie sans aucune discrimination. Les mariages inter–groupes très courants en sont une parfaite illustration. Bayakh, par sa diversité ethnique et religieuse, apparaît comme un îlot dans le Diender, fief traditionnel lébou et de confrérie tidiane(4).
- 1
- On peut affirmer sans risque d’erreur très importante que la création du village de Bayakh remonterait à plus de deux voire trois siècles de notre vécu actuel.
- 2
- La lignée des Abdou Khadre Diaw s’estompa du fait qu’elle n’était constituée que de filles.
- 3
- On dénombre même des familles libano syriennes comme la famille Gozhaël qui y implanta la première boulangerie en 1964 et une station d’essence ... elle est également à l’origine de l’électrification du carrefour.
- 4
- Bayakh, contrairement au village traditionnel de Diender est dominé par la communauté mouride avec la famille de Mame Mor Dia qui y a édifié une grande maison (Keur Sérigne Touba ) et organise chaque année une grande cérémonie religieuse.

Le cadre économique et stratégique
Partie intégrante de la région de Thiès, Bayakh, domaine écologique des « Niayes » constitue en réalité un jardin pour Dakar qui en dépend fortement.
Face à Dakar, grosse agglomération marquée par une exiguïté spatiale contraignante, Bayakh, prolongement de la lointaine banlieue de la capitale,est plus qu’un bouffée d’oxygène, un exutoire qui permet à la grande ville de « respirer » au risque d’étouffer ...
Ici, les déplacements vers Dakar ne se limitent plus à des voyages occasionnels, mais ils sont quotidiens et pendulaires. Bayakh, à la croisée des chemins sur la route des Niayes, a fini de bâtir sa configuration actuelle autour de deux carrefours : La route des Niayes de Rufisque à Mboro et la route de Km 50. Cette localité s’étend lentement mais sûrement autour des deux pôles dans toutes les directions : Nord (Kayar), Sud (Km cinquante), Est (Diender) et Ouest (Bambilor) .
C’est une position stratégique qui permet à ce village cité, mi rural, mi urbain, d’être une zone de convergence humaine, une porte d’entrée entre l’intérieur et la capitale, entre Dakar et sa lointaine banlieue ; un point de passage obligé des professionnels du maraîchage, de la pêche, de l’aviculture et de l’arboriculture.
Son dynamisme démographique, culturel et économique est tel que le conseil rural a été amené, à transférer une partie de la gestion administrative locale de Diender Guedj (chef lieu de la communauté rurale) du fait de son enclavement relatif à Bayakh.
Le long de ces deux axes routiers , Bayakh polarise une vingtaine de villages , ce qui explique en toute logique certainement le choix des autorités académiques pour abriter le premier CEM de la zone du Diender en 1999. Celui-ci, érigé en lycée en octobre 2008, est également appelé à polariser les CEM naissants de Djender Guedj (2006-2007), Kayar (2006/2007) et Keur Moussa (2007/2008).
Face à Dakar, grosse agglomération marquée par une exiguïté spatiale contraignante, Bayakh, prolongement de la lointaine banlieue de la capitale,est plus qu’un bouffée d’oxygène, un exutoire qui permet à la grande ville de « respirer » au risque d’étouffer ...
Ici, les déplacements vers Dakar ne se limitent plus à des voyages occasionnels, mais ils sont quotidiens et pendulaires. Bayakh, à la croisée des chemins sur la route des Niayes, a fini de bâtir sa configuration actuelle autour de deux carrefours : La route des Niayes de Rufisque à Mboro et la route de Km 50. Cette localité s’étend lentement mais sûrement autour des deux pôles dans toutes les directions : Nord (Kayar), Sud (Km cinquante), Est (Diender) et Ouest (Bambilor) .
C’est une position stratégique qui permet à ce village cité, mi rural, mi urbain, d’être une zone de convergence humaine, une porte d’entrée entre l’intérieur et la capitale, entre Dakar et sa lointaine banlieue ; un point de passage obligé des professionnels du maraîchage, de la pêche, de l’aviculture et de l’arboriculture.
Son dynamisme démographique, culturel et économique est tel que le conseil rural a été amené, à transférer une partie de la gestion administrative locale de Diender Guedj (chef lieu de la communauté rurale) du fait de son enclavement relatif à Bayakh.
Le long de ces deux axes routiers , Bayakh polarise une vingtaine de villages , ce qui explique en toute logique certainement le choix des autorités académiques pour abriter le premier CEM de la zone du Diender en 1999. Celui-ci, érigé en lycée en octobre 2008, est également appelé à polariser les CEM naissants de Djender Guedj (2006-2007), Kayar (2006/2007) et Keur Moussa (2007/2008).

Son lycée
Les infrastructures et équipements



A cela s’ajoute l’inexistence d’un plateau sportif et le déficit en bureaux, en armoires, en tables bancs, en matériels scolaires surtout des manuels et des cartes pour le second cycle.
Le lycée ne dispose pas du « minimum vital », c’est à dire l’électricité et le téléphone pour son fonctionnement correct ; ce qui entraîne des déboires d’ordre administratif, sécuritaire, pédagogique ...
Sans ces deux leviers, il est impensable que les élèves entrent dans l’ère de l’informatique, de parfaire leur recherche et de s’ouvrir surtout au reste du monde. Enfin avec l’absence d’une bibliothèque et surtout d’une salle spécialisée, les enseignements sont plutôt théoriques que pratiques et ne vont pas dans le sens de susciter une vocation scientifique au lycée (6).
- 6
- La série S1 n’existe pas au lycée et les élèves qui présentent de réelles dispositions scientifiques ont tendance à s’exiler vers les lycées de Pout et de Rufisque.

Les effectifs
Le lycée, sur l’ensemble de ses deux cycles, compte un effectif de 791 élèves dont 626 dans le 1er cycle soit 79%.
En terme de genre, on dénombre plus de garçons (452 soit 57% des élèves du lycée) que de filles (43%). La massification des effectifs féminins est surtout marquante dans le 1er cycle soit 82% de l’effectif des filles de l’école contre 18% seulement au 2nd cycle (59 filles).
Tableau I : Situation d’ensemble des effectifs du lycée (2008/2009)

NB : les 6emes et 5emes sont logées dans des abris provisoires (hangar)
Les élèves sont plus portés sur les lettres et les langues que les sciences.
Ce qui se traduit par l’inexistence de la série S1 en Première et en Terminale. Aussi sur les 165 élèves du 2nd cycle, seuls 59 élèves fréquentent la série S, soit 35%.
Cette tendance littéraire est surtout accentuée chez les filles qui, dans la série scientifique ne représentent que 18,64%.
Tableau 2 : Représentation des filles dans les classes scientifiques


En terme de genre, on dénombre plus de garçons (452 soit 57% des élèves du lycée) que de filles (43%). La massification des effectifs féminins est surtout marquante dans le 1er cycle soit 82% de l’effectif des filles de l’école contre 18% seulement au 2nd cycle (59 filles).
Tableau I : Situation d’ensemble des effectifs du lycée (2008/2009)

Les élèves sont plus portés sur les lettres et les langues que les sciences.
Ce qui se traduit par l’inexistence de la série S1 en Première et en Terminale. Aussi sur les 165 élèves du 2nd cycle, seuls 59 élèves fréquentent la série S, soit 35%.
Cette tendance littéraire est surtout accentuée chez les filles qui, dans la série scientifique ne représentent que 18,64%.
Tableau 2 : Représentation des filles dans les classes scientifiques